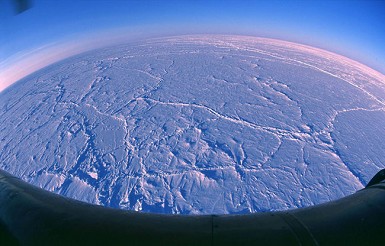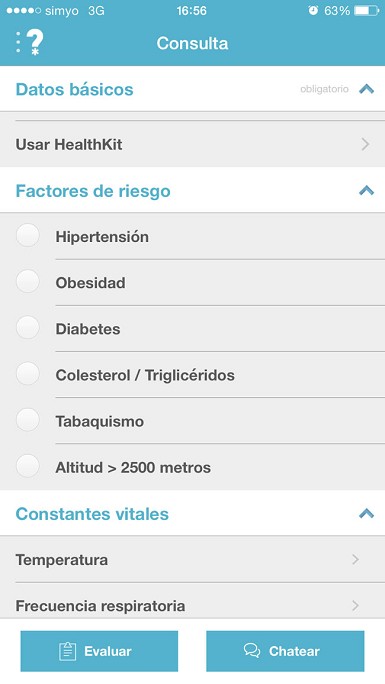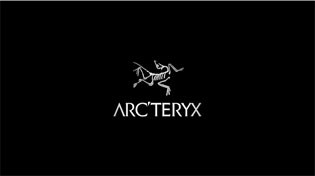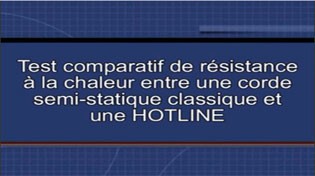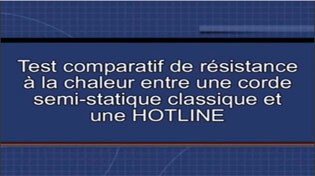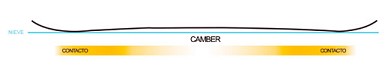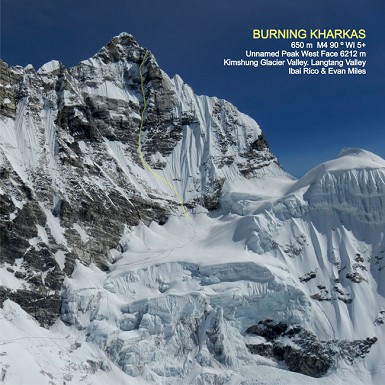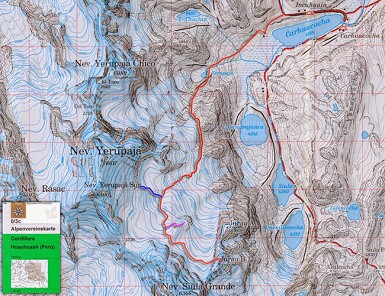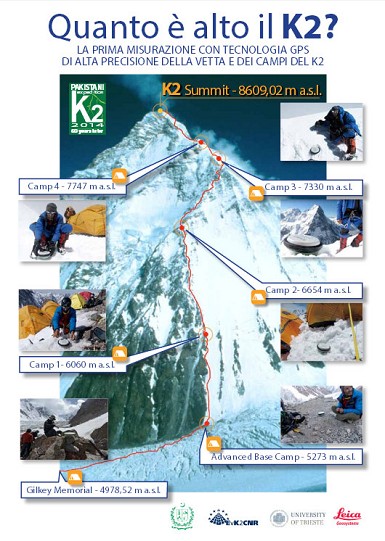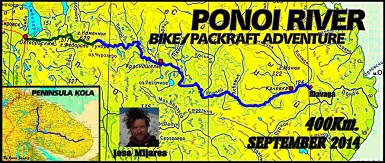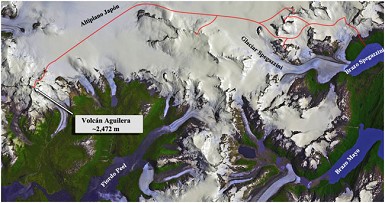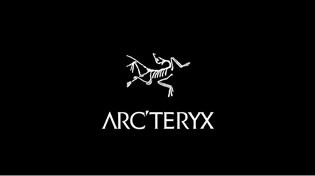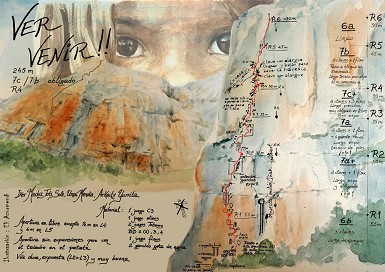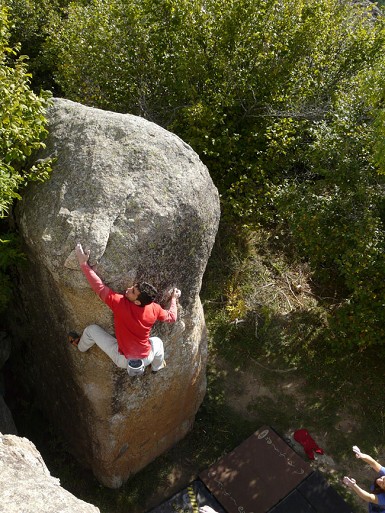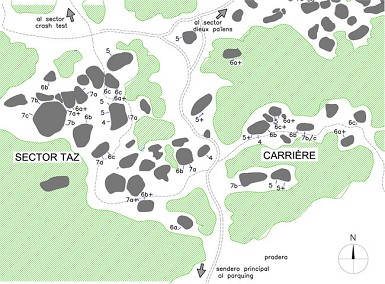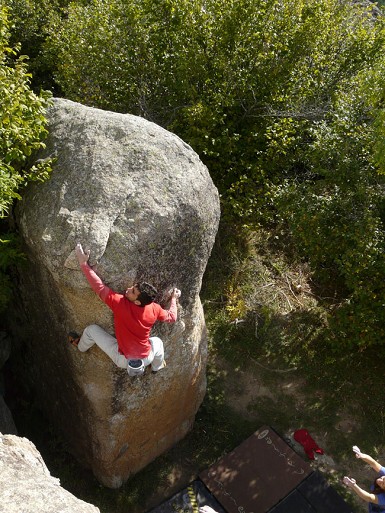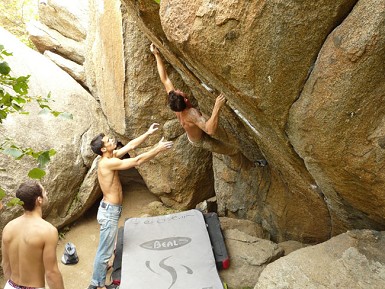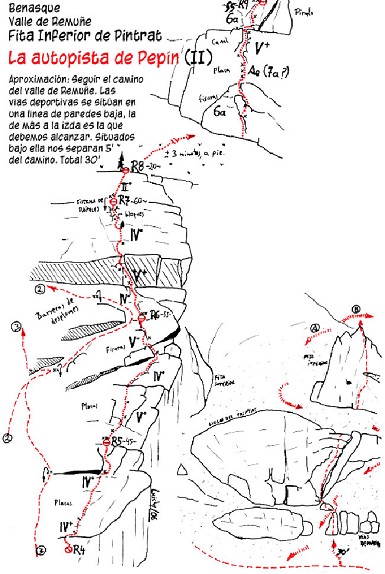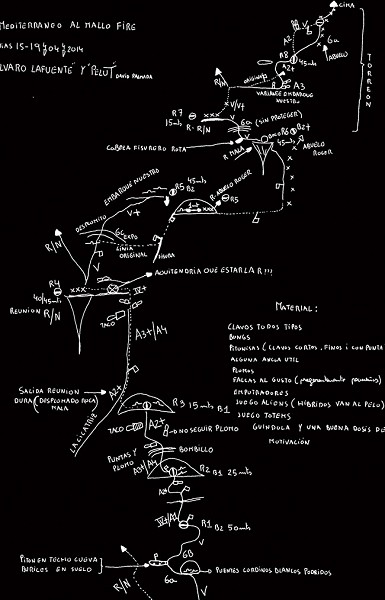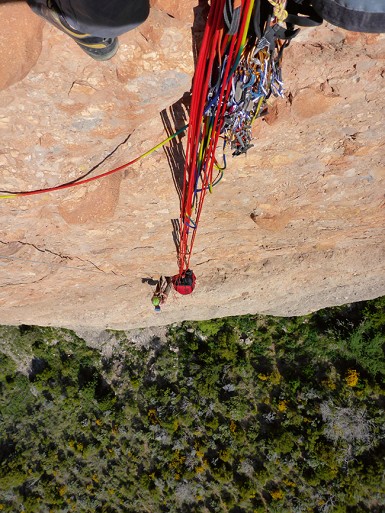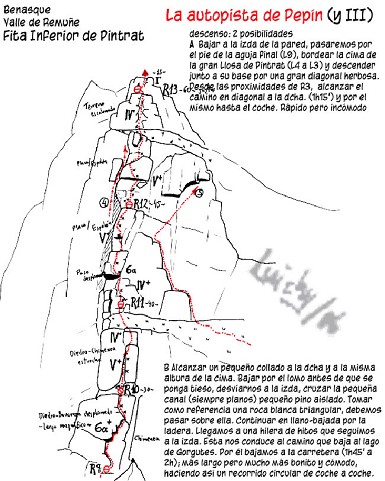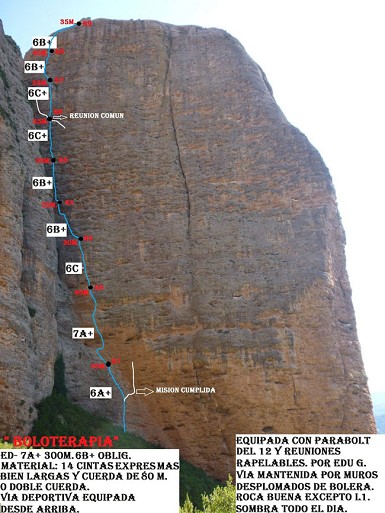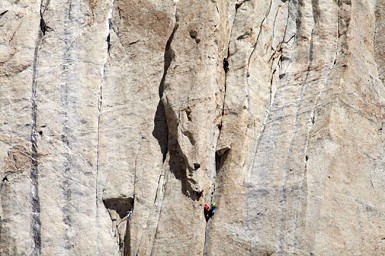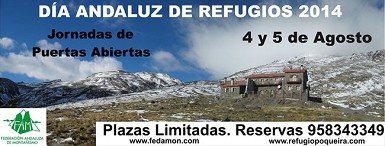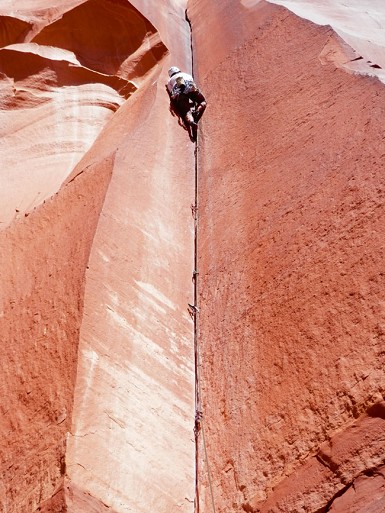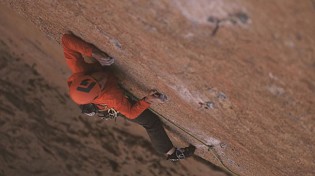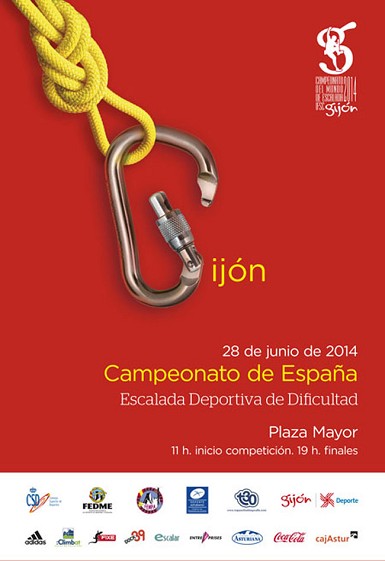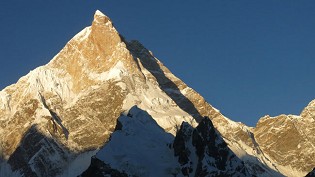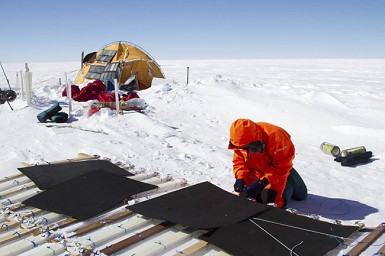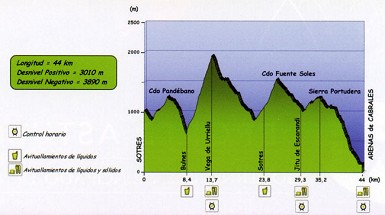Lavage des vêtements Gore-Tex : précautions et étapes à suivre
N'ayez pas peur. Parfois nous paniquons en voyant nos vêtements tourner dans la machine à laver et nous passons des moments d'angoisse jusqu'à ce que nous vérifiions que tout s'est bien passé, mais si vous lisez cet article vous verrez que c'est très simple et vous comprendrez les avantages du lavage pour le bon fonctionnement et la durabilité d'un vêtement Gore-Tex.